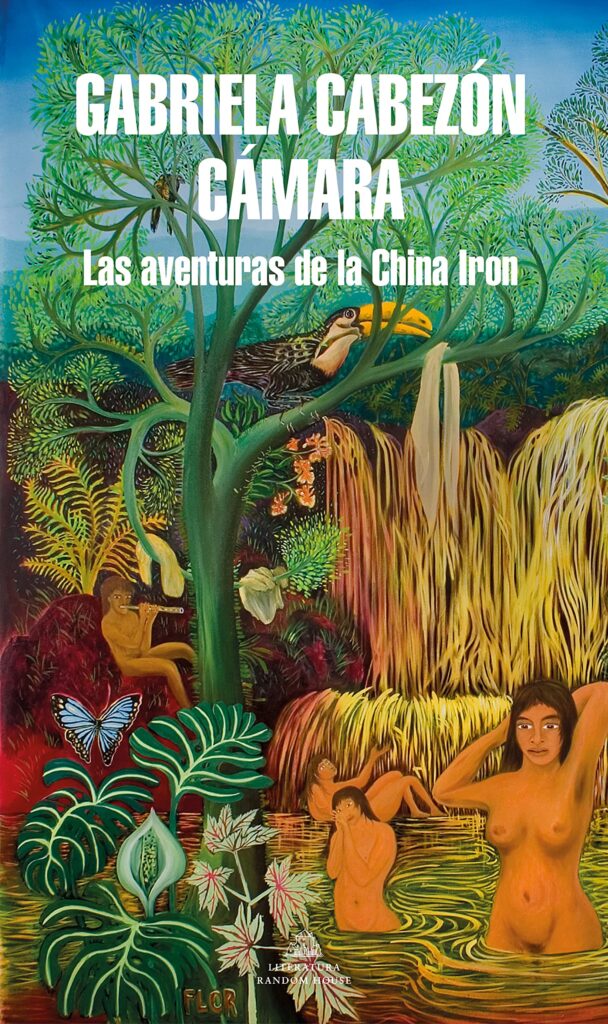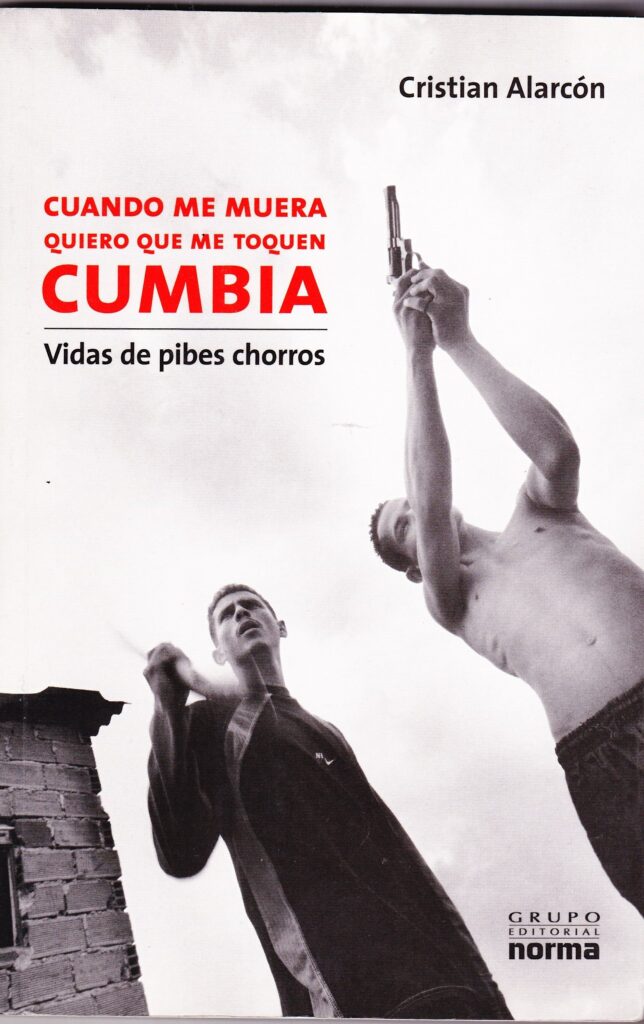Rompre avec l’héritage de la dictature
Pour beaucoup de jeunes Chiliens, le mouvement étudiant de 2011 représente un premier pas dans la vie politique du pays et une porte d’entrée vers une multitude de questionnements sur l’état de la société et leurs envies de changement. Comme l’explique Sofía Donoso, chercheuse au COES (Centre d’Etudes du Conflit et de la Cohésion Sociale), le sentiment d’un manque de représentativité du gouvernement, des députés et des politiques en général est un phénomène grandissant depuis les années 2000. La jeunesse chilienne ne se reconnait plus dans les partis traditionnels et trouve particulièrement difficile de se contenter du modèle dominant, alors qu’elle est confrontée au chômage, à un système éducatif à deux vitesses et à une précarité grandissante. Elle se distingue en cela de la génération traditionaliste qui a grandi dans les années 1980, et qui tend à mettre la famille et le travail avant la politique. Les défaillances du système néolibéral et individualiste promu par la dictature poussent la jeune génération à perdre confiance dans les principes de consommation excessive, d’achat à crédit et d’endettement promus par le système capitaliste.
Cette différence brutale de mode de vie, causée par une précarité toujours croissante, marque particulièrement les jeunes et nourrit leurs ressentiments. “Le système est de plus en plus violent. J’ai toujours ressenti beaucoup de colère contre ce système qui nous a tant promis quand nous étions enfants, alors qu’il tue et torture des gens pour perdurer”, explique Eduardo, revenant ainsi sur les profondes traces laissées par la dictature dans la société chilienne du XXIème siècle. Car les marches de 2011 participent, à leur façon, à une remise en cause du roman national promu par le régime de Pinochet et ses défenseurs depuis des décennies.
“Le discours qui prône qu’Allende était mauvais et qu’il fallait tuer les communistes, c’est peut-être encore suffisant pour la droite radicale, mais ça ne l’est plus pour 80 % des Chiliens. Il faut cependant continuer à combattre cette droite, à la disséquer, la démanteler et la désarmer, pour toutes les personnes qui manifestent dans le rue” ajoute Eduardo. Car la société chilienne reste polarisée, notamment sur la question des années Pinochet et de l’impunité des anciens “fonctionnaires de la dictature”, toujours populaires dans une partie de la population, et qui parviennent encore à occuper le devant de la scène, comme l’a fait José Antonio Kast lors de l’élection présidentielle ou Jorge Arancibia Reyes, ancien aide de camp de Pinochet et membre de la commission pour les droits de l’homme de la nouvelle constitution.
Mais le mouvement de 2011 arrive certainement trop tôt, et une partie de la population n’est pas prête à faire valoir dans les urnes les demandes de la rue. Malgré la longueur et la ténacité des manifestants et quelques concessions du gouvernement, l’espoir finit par s’étioler. “On avait tous l’espoir de changer le système éducatif chilien à ce moment-là… Mais ça n’est pas arrivé » raconte Eduardo, avant d’ajouter qu’il est « parti du Chili le cœur brisé par la politique”.
Depuis 2011, des personnalités issues du mouvement étudiant ont pu accéder à des fonctions représentatives au Sénat ou au gouvernement. On pense par exemple à Camila Vallejo, auréolée de son statut de dirigeante de la Fédération des Étudiants de l’Université du Chili (FECh) et d’une reconnaissance internationale, qui a participé à porter la voix d’un certain mécontentement populaire au sein du parlement sous l’étiquette du PC. Cette nouvelle génération s’est exprimée à travers la création du Frente Amplio, une coalition politique qui a culminé aux législatives de 2017 par l’élection de 20 parlementaires et un sénateur. Sofía Donoso parle du Frente Amplio comme d’un “parti-mouvement”, soit un parti directement issu d’une mobilisation sociale et dont les représentants se sont formés à la politique en dehors des circuits habituels, ce qui leur confère une plus grande légitimité auprès d’un peuple découragé par les modèles politiques traditionnels.
Si les anciens leaders étudiants du mouvement de 2011 ont pu s’établir aussi bien en politique, c’est aussi car ce mouvement était le plus important dans l’histoire du pays – avant l’estallido de 2019. Au-delà de leur ampleur et de leur durée, les manifestations ont abouti à des changements de fond dans le système éducatif chilien, comme l’abrogation de la principale loi sur l’enseignement secondaire, de substantielles hausses de budget, la création de nouveaux organismes publics de régulation, ou encore la création de bourses. Les sondages ont révélé que 70% de la population soutenait le mouvement et ses demandes en faveur d’une éducation gratuite et de bonne qualité.
Mais des réserves subsistent sur la capacité des anciens leaders étudiants à réellement pouvoir implémenter leur politique. Car les figures les plus connues du grand public – à savoir Camila Vallejo, Giorgio Jackson et Gabriel Boric – ont souvent pu être considérées comme “les figures des médias” et non pas de vrais porte-parole des manifestants. Comme l’explique Sofía Donoso “quand un parti politique se sent menacé, il va faire des efforts pour se rapprocher des mouvements sociaux qui sont, par définition, plus proches des demandes directes du peuple.” Mais en permettant à des figures issues de ces mouvements de se « professionnaliser », le pouvoir en place leur fait également perdre une partie de l’authenticité et de la légitimité qu’elles pouvaient avoir auprès de leurs compagnons militants. Mais si les figures de proues de 2011 se sont assagies au fil des années et des compromis avec le pouvoir en place, elles ont néanmoins participé à représenter une société civile qui défend des problématiques féministes, raciales et environnementales.
En 2019, le mouvement s’enrichit d’un point de vue identitaire et a à cœur de célébrer son passé, en revisitant l’identité chilienne et en multipliant les références à d’anciennes luttes sociales, en particulier celles de l’Unidad Popular d’Allende. Lors des manifestations, on peut entendre le groupe Inti-Illimani interpréter la chanson El Pueblo Unido Jamás Sera Vencido, reprise en choeur par des milliers de personnes sur la Plaza de la Dignidad, ou voir des gens jouer du chinchín dans les rues de Santiago, et scander des chansons traditionnelles comme El Baile de la tinaja, ce qui apparaît comme la réinterprétation d’une culture longtemps dénigrée par le pouvoir en place.
“Les chansons officielles des fêtes patriotiques instaurées pendant la dictature, ça n’était pas la cueca traditionnelle de la campagne, c’était la cueca latifundiste, avec des harmonies importées d’Europe, un beau costume et un mouchoir blanc… une danse de salon, en somme”. Cette imposition culturelle s’est accompagnée d’une idéologie mythique de l’individualisme, pur produit de l’école de Chicago, qui a influencé une grande partie de l’économie et de la culture sous Pinochet. Un mythe hérité de la dictature, mais qui s’est imposé avec le temps comme la vérité officielle. “Je crois que les soulèvements de 2019 ont réinventé une identité, quelque chose dont les gens sont fiers, et que la droite ne peut pas effacer. La fierté d’une tradition qui n’est ni celle du paysan, ni celle du policier ; une sorte de contre-culture qui puise à la source de nos traditions pluri-ethniques” affirme Eduardo.
La revendication d’un passé longtemps dénigré et la proclamation d’un État pluri-national sont des points nodaux dans les discussions politiques qui ont animé l’Assemblée constituante et le pays au cours des derniers mois. Et malgré la victoire du rechazo (non) à la première proposition de nouvelle Constitution en septembre dernier, le changement est en marche au Chili. « La situation politique et les blocages institutionnels ne peuvent que mener à une autre révolte sociale dans les années qui viennent » affirme Eduardo, « Ma seule crainte est qu’elle soit encore plus violente que celle de 2019, car les gens n’ont hélas plus grand chose à perdre » conclut-il.
Élise PIA
Lyon, mai 2022.
___